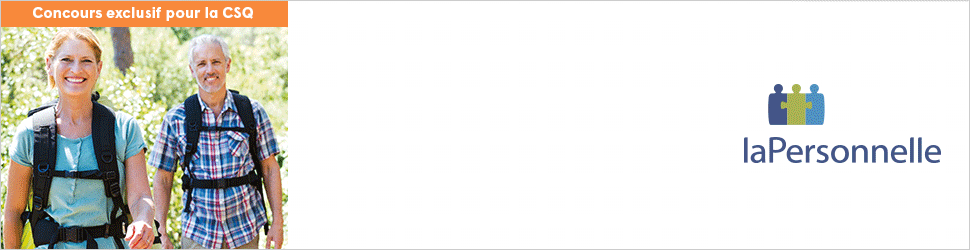Karine Dubois est maman de trois enfants. Bien qu’ils soient encore petits, elle a commencé à se questionner sur leur entrée au secondaire en observant d’autres parents de son entourage. « Plusieurs ont l’impression que c’est l’avenir de leur enfant qui se joue en faisant ce choix. Et la pression sur les jeunes est extrêmement forte », raconte-t-elle. Une réalité que la productrice et fondatrice de Picbois Productions a décidé d’explorer dans la série de balados Chacun sa classe, diffusée sur Ohdio.
Au fil de ses recherches, Karine Dubois a constaté que la situation avait bien changé depuis le moment où elle fréquentait elle-même le secondaire, dans les années 1990. « On ne se posait pas trop de questions à l’époque et on allait à la polyvalente de son secteur », se rappelle-t-elle. Or, le choix de l’école de quartier ne s’impose plus d’emblée. La part des élèves qui fréquentent une école privée n’a cessé d’augmenter depuis, passant de 5 % en 1970 à 20 % aujourd’hui, selon les données du mouvement École ensemble. Pour faire concurrence aux écoles privées et retenir les élèves, les écoles publiques ont multiplié l’offre de programmes particuliers, dont la plupart sont sélectifs. En 2022, plus d’un élève sur cinq s’y retrouve, toujours selon École ensemble. La possibilité, pour les parents, de choisir un établissement scolaire autre que l’école de quartier, en fonction des projets qui y sont offerts, a aussi contribué à cette tendance.

Si bien qu’entre l’école privée et les établissements secondaires à projets particuliers, c’est la course effrénée pour ne pas être « en rien », c’est-à-dire au régulier, comme le disent les jeunes. « Ce qui m’a aussi frappée, c’est le niveau de sélection pour les programmes particuliers dans le public, dit Karine Dubois. Par exemple, pour s’inscrire à un programme d’arts et média dans une école montréalaise de mon quartier, il fallait une lettre de recommandation d’un enseignant spécialiste et d’un titulaire, une vidéo où l’enfant se présente, un formulaire… C’est vraiment intense pour un jeune de sixième année. » Et ce n’est pas unique à Montréal, a-t-elle constaté.
Ce système, que l’on qualifie d’à trois vitesses (voire plus), est dénoncé par plusieurs, dont le Conseil supérieur de l’éducation, explique Stéphane Vigneault, cofondateur et coordonnateur du mouvement École ensemble. Selon le conseil, le système québécois serait le plus inégalitaire au pays, avec les taux de décrochage les plus élevés au Canada. Même l’ONU a formellement demandé au gouvernement du Québec, en 2020, quelles étaient « les mesures prises pour assurer l’égalité d’accès à l’éducation dans le cadre du système scolaire à trois niveaux au Québec, indépendamment de la situation économique des parents », rapporte École ensemble. « On attend toujours la réponse qui aurait dû parvenir à Genève en juin 2021 », ajoute Stéphane Vigneault.
Le poids de la concurrence
« Ce système à deux, trois, voire plusieurs vitesses, favorise une différenciation des parcours, une ségrégation et des exclusions subtiles. Oui, l’école est obligatoire, gratuite et ouverte à tous. Toutefois, cette concurrence entre l’école publique et l’école privée a amené ces dernières à séparer les élèves. Les formations offertes sont donc différentes et inégales si l’on compare celles des programmes réguliers, particuliers et privés », explique Pierre Canisius Kamanzi, professeur au Département d’administration et fondements de l’éducation de l’Université de Montréal.
D’abord, en sélectionnant les élèves selon leurs résultats scolaires et en exigeant des frais d’inscription, même minimes, plusieurs enfants n’ont pas accès aux programmes les plus motivants et les plus formateurs. « La facture peut être très salée, mais dans les familles moins bien nanties, les couts n’ont pas besoin d’être très élevés pour rendre inaccessibles ces options. Aussitôt qu’il y a une facture, il y a une fracture », souligne Stéphane Vigneault.
Cette séparation qui s’opère dès l’âge de 11 ou 12 ans reproduit ainsi les inégalités sociales en concentrant les élèves les plus vulnérables, souvent plus défavorisés, ensemble. « Cela ne laisse pas non plus beaucoup de chance aux enfants de se rattraper », estime Pierre Canisius Kamanzi. De plus, les classes où sont regroupés les élèves les plus forts bénéficient généralement d’un meilleur encadrement – de la part des parents, mais également de l’école. « On a tendance à exiger plus des élèves qui réussissent bien, à afficher des attentes plus élevées et à demander aux jeunes d’être plus engagés », note-t-il. À l’inverse, les attentes ont tendance à être moins élevées dans les classes où se concentrent les élèves les plus vulnérables.

De plus, cela se reflète sur les matières enseignées pendant leur parcours, ajoute le chercheur. « Le contenu est aussi différent, puisque les élèves inscrits au régulier n’ont pas accès à des programmes de sport, de musique ou d’art, qui leur permettent de développer leur estime de soi et d’acquérir de nouvelles connaissances. » Or, les études montrent que la mixité n’a pas d’effets négatifs sur les plus forts, mais a tendance à aider les plus faibles à remonter la pente quand ils ne sont pas en surnombre. Bref, l’équilibre apporte des bienfaits à tout le monde.
Les conséquences de cette ségrégation se font sentir à long terme, a mesuré le chercheur. Plus de 90 % des élèves du public enrichi ou du privé accèdent au cégep, alors que seule la moitié des élèves du régulier s’y inscrivent, rapporte Pierre Canisius Kamanzi. Le fossé est encore plus grand à l’université. Seulement autour de 15 % des élèves diplômés du régulier se retrouvent aux études supérieures, alors que cette proportion grimpe à 60 % et à 50 % chez les diplômés du privé ou d’un programme enrichi respectivement.
Des pistes de solutions possibles?
Pour éliminer cette concurrence et la ségrégation qu’elle engendre, il faudrait revenir au concept d’écoles de quartier en mettant de côté la sélection des élèves, plaide Stéphane Vigneault. « Comment cela pourrait-il s’incarner? D’abord, en mettant sur pied un réseau commun incluant les écoles publiques et des écoles privées, où chaque école se verrait attribuer un bassin scolaire. Le magasinage d’école, le stress des parents, l’angoisse des enfants et le marketing des écoles deviendraient alors chose du passé », explique-t-il. Comme pour le primaire, chaque adresse se verrait attribuer une école. C’est du moins une des idées maitresses du Plan pour un réseau scolaire commun, présenté par le mouvement en mai 2022.

Le regroupement propose aussi d’inviter les écoles privées à joindre ce réseau. Elles seraient alors subventionnées à 100 %, en échange de quoi elles devraient accepter tous les élèves de leur bassin, sans sélection et sans frais. « Si certaines écoles privées ne veulent pas se joindre à ce réseau commun, elles auraient le choix. Elles continueraient d’exister, mais ne recevraient aucun fonds public. C’est déjà le cas en Ontario », détaille Stéphane Vigneault.
Ce réseau commun éliminerait la concurrence entre les établissements. « Les écoles n’ont toutefois pas à être toutes pareilles, toutes beiges, pour autant », ajoute-t-il. Pour donner une couleur à chacun des établissements, le regroupement suggère que ceux-ci ajoutent des projets particuliers accessibles à tous, gratuitement. Une façon d’augmenter la motivation, de stimuler le sentiment d’appartenance et d’enrichir le parcours de tous les élèves, selon Stéphane Vigneault.
Chaque établissement pourrait inventer son propre modèle, à condition de respecter le principe de libre choix des programmes. Stéphane Vigneault cite en exemple une école de Princeville qui a retranché 15 minutes à chaque période de cours. Le temps ainsi gagné permet d’ajouter une case horaire par jour dédiée aux parcours particuliers de chaque élève. Une formule qui semble plaire à toutes et tous, souligne le coordonnateur.
Enfin, la carte scolaire du réseau commun serait découpée de manière à ne pas reproduire les iniquités sociales dans les murs des écoles. Certains pays ont testé cette formule qui fonctionne généralement assez bien. Mais quand ce n’est pas le cas, « nous proposons de bonifier le budget des écoles pour des projets d’agrandissement, pour l’achat de livres, d’équipements ou pour des sorties culturelles », cite en exemple Stéphane Vigneault.
Une vision à laquelle adhère Pierre Canisius Kamanzi. « Au Québec, il faudrait tout simplement que les conditions d’admission dans une école privée ou publique soient les mêmes. En d’autres mots, chaque établissement, public ou privé, devrait être dans l’obligation de scolariser tous les élèves résidant sur son territoire, et aucune condition de renvoi ne devrait être admise. » Ne plus séparer les enfants aurait aussi un impact sur la cohésion sociale, puisque le fait d’être en contact avec des gens de tous horizons favorise l’ouverture et le vivre-ensemble à l’école comme dans la société.
Un projet collectif
Bref, pour Stéphane Vigneault, apprendre ensemble, c’est « niveler vers le haut ». « Quand on présente notre plan, les gens se questionnent au début. Mais quand ils comprennent, ils se remettent à rêver. Car ce dont il est question ici, c’est de choix politiques. Et ces changements seraient bénéfiques pour tout le monde », plaide-t-il. Le mouvement travaille d’ailleurs à modifier les perceptions, et les politiques.
C’est aussi la voie que prône Karine Dubois. Elle estime que cette cause ne peut être portée seulement par les parents et doit être collective. « C’est d’autant plus difficile que les familles qui sont dans cette troisième voie n’ont pas toujours le temps, les connaissances ou les ressources pour mener cette bataille. » La productrice aimerait aussi que les règles du jeu soient modifiées avant l’arrivée de sa plus jeune, âgée de 3 ans, au secondaire, même si elle estime que c’est peu probable. En attendant, elle espère que sa série de balados permettra de conscientiser la population au phénomène de la ségrégation scolaire.