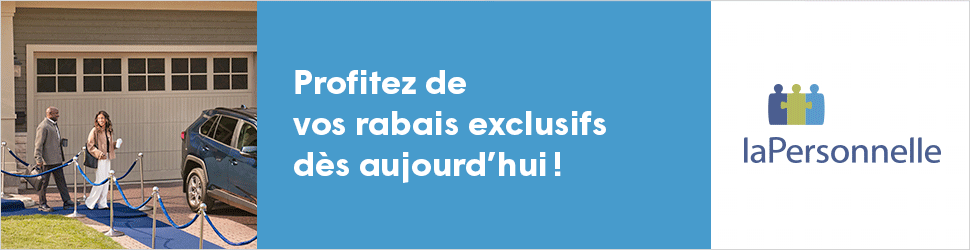Action féministe
Trente ans après Beijing : des avancées encore fragiles
7 avril 2025
Trente ans après l’adoption de la Déclaration et Programme d’action de Beijing, les droits des femmes progressent, mais des reculs persistent. Un pays sur quatre signale une détérioration de ces droits, et la récente déclaration politique adoptée par la 69e session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies, qui a eu lieu en mars dernier, souligne de sérieuses lacunes.
Par Julie Pinel, conseillère CSQ
En 1995, lors de la 4e Conférence mondiale sur les femmes, les 189 pays présents ont unanimement adopté ce que l’on appelle aujourd’hui la Déclaration et Programme d’action de Beijing. Son objectif : reconnaître la nécessité de repenser la structure de la société ainsi que l’ensemble des relations entre les femmes et les hommes qui la composent, afin de permettre aux femmes d’occuper pleinement la place qui leur revient de droit, et ce, dans tous les aspects de leur vie.
Trente ans après son adoption, il est indéniable que cette plateforme d’action a contribué aux avancées des droits des femmes à travers le monde. Toutefois, le chemin à parcourir reste long dans chacun des 12 domaines d’intervention sur lesquels cette plateforme agit (voir ci-bas).
Dans un contexte où un pays sur quatre enregistre des reculs en matière de droits des femmes, l’adoption de la Déclaration rappelle à quel point il est encore essentiel de lutter pour améliorer leur quotidien.
Des recommandations ambitieuses, mais insuffisantes
La récente déclaration adoptée en mars 2025 lors de la 69e session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies, à laquelle la CSQ a participé, présente plusieurs objectifs ambitieux qu’il convient de saluer.
Tout d’abord, les pressions exercées par les organisations syndicales ont permis d’inclure la promotion, le respect, la protection et la garantie du droit des femmes au travail et sur les lieux du travail. La déclaration reconnaît également le droit d’être membre d’une organisation syndicale, de négocier collectivement les conditions de travail, ainsi que celui d’évoluer dans un milieu exempt de violence et de harcèlement. Toutefois, aucune mention n’est faite sur la Convention no 190 de l’Organisation internationale du Travail sur la violence et le harcèlement, alors qu’elle constitue une référence incontournable en matière de bonnes pratiques.
La déclaration met par ailleurs en lumière l’inégalité persistante dans le partage des tâches domestiques et des responsabilités liées aux soins des enfants et de la famille. Elle engage les pays signataires à promouvoir un partage égalitaire des responsabilités et à prioriser les investissements publics dans les soins afin d’en améliorer l’accessibilité tout au long de la vie. Alors que le gouvernement applique des politiques d’austérité dans nos services publics, cette déclaration vient à point pour lui rappeler l’importance de ces derniers dans la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Malheureusement, en matière de services de soins, la déclaration présente les partenariats public-privé comme une voie à suivre pour parvenir à l’égalité. Or, les recherches actuelles montrent que ce type de partenariat précarise trop souvent les conditions de travail et favorise un accès à deux vitesses, donc inégal, aux services de santé et d’éducation.
Enfin, la déclaration omet toute référence à la santé sexuelle et reproductive des femmes ainsi qu’à la transition juste. Ces deux éléments sont pourtant des composantes essentielles dans l’atteinte d’une réelle égalité.
Les droits des femmes sont aussi des droits humains
L’adoption de la Déclaration de Beijing, en 1995, a consacré un principe fondamental : les droits des femmes sont aussi des droits humains. Trente ans après, dans un contexte où les reculs persistent et où les femmes se mobilisent pour défendre leurs acquis, ce slogan résonne plus que jamais pour affirmer notre refus de toute régression.
Cette déclaration joue un rôle crucial dans l’atteinte de l’égalité pour toutes et tous. Grâce aux efforts des organisations syndicales et des organismes féministes, elle reconnaît l’importance des milieux de travail égalitaires et du travail de soins dans l’atteinte de l’égalité.
Il est primordial de maintenir la pression sur les gouvernements afin de s’assurer, dans ce contexte d’austérité, que les femmes ne soient pas, une fois de plus, les grandes perdantes des crises, notamment économiques. Investir dans les services publics, c’est construire une société soucieuse à la fois des générations futures, mais également de l’égalité entre les femmes et les hommes.