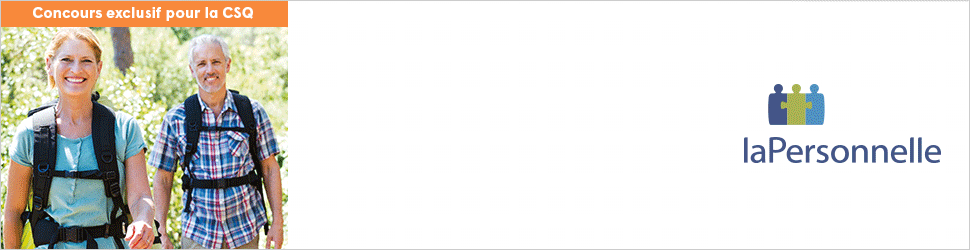En 2017, l’auteure, chroniqueuse et féministe assumée Judith Lussier a mis un terme à sa chronique d’opinion dans le Journal Métro. Les commentaires haineux qu’elle recevait sans cesse sur le site du journal, mais également sur sa page Facebook, étaient devenus pour elle une source d’épuisement.
En entrevue à Radio-Canada, elle racontait à l’époque qu’elle avait fini par croire que la violence dont elle était la cible faisait partie de son travail. Or, « personne ne mérite de vivre autant d’agressivité dans son travail », disait-elle.
Un phénomène en croissance
La quantité, la rapidité et la sévérité des commentaires en ligne à l’égard des femmes augmentent sans cesse, faisait remarquer Véronique Pronovost, doctorante en sociologie et membre du Chantier sur l’antiféminisme du Réseau québécois en études féministes, lors d’une conférence tenue en novembre 2021 dans le cadre de la campagne des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes.
Les médias sociaux sont souvent utilisés comme un outil de harcèlement. La violence et les menaces envers les femmes qui prennent position publiquement sur différents enjeux y sont devenues monnaie courante.
Les antiféministes n’hésitent pas à se servir des réseaux sociaux pour commenter les propos et les idées des militantes, mais aussi pour dénigrer leur physique. Et malheureusement les commentaires homophobes, transphobes, grossophobes, etc. accompagnent fréquemment le cyberharcèlement.
Des groupes qui s’organisent
« Le Web n’est qu’un terrain de jeu de plus pour les antiféministes », selon Véronique Pronovost. Ces personnes s’y regroupent, se donnent des conseils et développent des stratégies pour faire plus de bruit. Elles accaparent par exemple les fils de discussion, les blogues, les pages professionnelles et même personnelles des militantes. Elles misent sur les émotions, comme la peur, pour les déstabiliser.
« Pour bon nombre de féministes 2.0, les représailles peuvent se faire sentir très rapidement, surtout de la part d’hommes antiféministes qui s’organisent eux aussi en ligne sur diverses plateformes pour intimider, menacer de mort ou de viol, insulter ou encore s’adonner au doxxing, soit la divulgation en ligne de renseignements privés (adresses IP et résidentielles), ou au partage non consenti de photos intimes », explique Kharoll-Ann Souffrant, candidate au doctorat en service social à l’Université d’Ottawa, dans son texte « Mouvements sociaux et féminismes en ligne à l’ère de #MoiAussi », paru dans l’ouvrage L’état du Québec 2022.
Des répercussions majeures
La violence en ligne peut rapidement mener au désengagement. Les femmes deviennent plus hésitantes à prendre la parole par peur des conséquences sur leur vie personnelle et leur vie professionnelle, soulignait Véronique Pronovost. Elles s’autocensurent ou vont jusqu’à faire ce qu’on appelle un « burnout militant ».
La cyberviolence et le cyberharcèlement laissent aussi des séquelles, comme l’anxiété et la perte d’estime de soi.
Mettre fin à la problématique
Il n’est pas normal de se faire insulter, ou de recevoir des menaces de mort ou de viol, peu importe qu’on soit une femme, une militante, une féministe, une élue, une personnalité publique ou tout cela à la fois.
Savoir reconnaitre le cyberharcèlement et la cyberviolence, dénoncer, porter plainte quand c’est possible, utiliser les outils numériques disponibles (par exemple, les options de blocage de commentaires ou de personnes) et sécuriser ses comptes de médias sociaux en modifiant les paramètres, voilà quelques moyens individuels qui peuvent être mis en place pour réduire les dérapages en ligne, d’après Nellie Brière, consultante en médias numériques et réseaux sociaux.

Lors de la conférence à laquelle elle a aussi participé, elle mentionnait que la responsabilité de mettre fin à la violence en ligne incombe aussi aux organisations et aux entreprises. Elles doivent mettre en place des politiques claires pour encadrer les commentaires sur leur plateforme, et offrir de la formation et du soutien à leurs employées et employés qui doivent, par exemple, gérer les médias sociaux.
Selon Nellie Brière, il est important que « les Judith Lussier de ce monde ne croient plus que [la cyberviolence] fait partie de leur travail ». C’est un devoir de société que d’agir pour y mettre fin.